— Je veux que vous me parliez d’elle, Peter. Depuis deux mois que nous avons commencé nos séances, pas une seule fois vous ne vous êtes ouvert à moi. Dites-moi, comment est-elle ? À quoi ressemble-t-elle ? Comment s’exprime-t-elle ? Quelle est son odeur ?
D’une voix caverneuse, la psychiatre de l’établissement pénitentiaire, au tailleur bleu ciel bien trop chic pour que je puisse ne serait-ce que me sentir à l’aise à me trouver dans la même pièce qu’elle, m’analyse.
Elle me questionne. Pense pouvoir me comprendre, cerner mes pensées, les plus primitives de mes pulsions, celles qui ont fait que moi, un homme, en suis venu à ôter la vie à huit êtres humains...
Un assassin… Un uxoricide… Un violeur…
— Je suis si fatigué de vivre sous son emprise… lui dis-je, en tirant une nouvelle fois sur mon mégot de cigarette. Fatigué de voir ses yeux m’observer chaque nuit.
Les cendres tombent à terre, emportées par un léger courant d’air provoqué par la petite fente sous la porte du bureau, au plancher en bois grinçant.
— Dans ce cas… qu’attendez-vous pour vous libérer d’elle, Peter ? me dit-elle calmement.
Ses yeux gris me transpercent, sans doute indifférents à ma souffrance. N’imaginant pas l’étendue de la noirceur des tourments dont je suis victime. Mais… me croirait-elle réellement ?
D’un air dégoûté, elle fixe la croûte épaisse qui s’est reformée sur mon doigt mutilé. Du pus suinte lentement.
Je regarde par la fenêtre. Le ciel est gris, lourd, empoisonné par une brume épaisse qui engloutit la ville.
Puis, mon regard se pose sur ma psychiatre.
Assise face à moi, son carnet sur les genoux, son stylo danse sur le papier, noircissant la page de ses observations.
Je lui adresse alors un sourire ironique.
Un geste que les muscles atrophiés de mon visage, déformés par la graine du mal, semblaient avoir oublié.
En quelques mois à peine, mon corps s’est flétri, comme si j’avais vécu une existence entière en accéléré, sur cette foutue planète Terre.
— Je ne peux me défaire d’elle, lui dis-je en la fixant droit dans les yeux. Plus maintenant... Je lui appartiens.
Le point de bascule de ma vie eut lieu cette nuit du treize mai deux mille onze. Une fin de journée usante, semblable à tant d’autres.
Une énième journée de travail, rythmée par des clients ignorant mes appels d’offres, convaincus que moi, l’un des commerciaux les plus aguerris de ma boîte de conseil, pourrais baisser mon froc lors des négociations de contrats.
À cette époque, ma femme était mon monde. Nous nous étions rencontrés grâce à un client devenu un ami, lors d’un afterwork. Ses lèvres roses et pulpeuses, ses yeux bleus et cette manière si particulière d’attacher ses longs cheveux argentés en un chignon faussement négligé m’avaient toujours fait penser que j’étais l’homme le plus chanceux. Belle et intelligente, elle était mon équilibre, mon tout, ma fierté. Et lorsqu’un soir de 1993, elle m’annonça que j’allais devenir père, mon bonheur fut complet. J’avais l’impression d’avoir atteint le but de toute une vie.
Le jour le plus heureux de ma vie fut celui où ma fille vit le jour, par césarienne, à l’hôpital Saint-Henri du Marais.
Mais ce plus beau cadeau devint aussi mon plus grand cauchemar, ma plus grande perte et ma plus grande faiblesse. Le début de ma descente aux enfers.
Le soir, en rentrant du travail, alors que ma femme et ma fille m’attendent dans le salon pour le dîner, je suis attaqué. À peine ai-je sorti mes clés que je sens un violent coup s’abattre sur l’arrière de mon crâne.
Le reste est un trou noir.
Un vide immense qui s’élargit et s’approfondit chaque fois que j’essaie de me souvenir.
Lorsque je reprends connaissance, je suis ligoté dans mon propre salon. Un morceau de chiffon poussiéreux dans la bouche et sur les lèvres, du scotch enroulé autour de tout mon visage.
Face à moi, ma femme et ma fille, terrorisées, en pleurs, et elles aussi ligotées et bâillonnées.
Deux hommes masqués, vêtus de noir, saccagent notre maison. Vident le contenu du coffre où étaient rangés nos bijoux, et quelque sept-mille euros en espèce. L’un d’entre eux parle avec un accent maghrébin. Un accent des cités du nord de Bruxelles. Tandis que le second, plus silencieux, fixe ma fille d’un regard immonde, un revolver en main.
Je me débats de toutes mes forces. Je crie, je hurle, j'appelle à l’aide, l’implorant de ne pas poursuivre ses pensées abjectes.
Mais l’homme a déjà enfilé sa masculinité en ma fille… de force…
Sous mes yeux. À moi, son père.
À cet instant, mon monde s’effondre. L’autre homme s’en amuse, me forçant à regarder la scène. Le fil de sa lame, glaciale comme la mort, effleure ma gorge en feu.
Après m’avoir roué de coups et poignardé à plusieurs reprises, il se dirige vers ma femme.
Il lui crache au visage, l’humilie, lui arrache sa robe, l’insulte… puis lui inflige le même sort qu’à ma fille.
Sous mes yeux. À moi, son mari.
Ma famille ne se remettra jamais de cette tragédie. Ma fille se mura dans le silence le restant de l’année, quitta son collège, refusa de voir ses amis, pour finalement se donner la mort, le 24 septembre de cette même année, en se jetant sous un train à Gare du Midi. Une lettre avait été rédigée à notre attention.
À moi, son père, ainsi qu’à ma femme, sa mère.
Couchant sur papier, avec ses mots d’adolescente, son geste désespéré. Elle disait vouloir rejoindre sa grand-mère dans un monde de paix, un monde où le mal ne pourrait plus l’atteindre.
Quelques larmes, séchées sur le papier, avaient dilué ses mots à certains endroits. Crus et brefs. Elle nous demandait de lui demander pardon.
Ma femme, quant à elle, perdit toute volonté de vivre, comme moi. Ne ressentant plus de désir, plus de tristesse, plus de colère. Juste un vide, creux et résonnant.
Un mur s’éleva alors entre nous. Et, après des sessions interminables chez des thérapeutes de couple siphonnant le peu d’argent qu’il nous restait, tentant de sauver le lien unique qui nous reliait, notre relation empira, se dégrada de jour en jour.
Pour ma femme, je ne suis plus qu’un meuble de la maison. Et moi… je ne vois plus sa beauté. Ni en elle, ni sur elle.
Elle, qui fut jadis mon rayon de soleil, ma source de bonheur inconditionnel, est à présent devenue ma source d’angoisse.
Sa simple présence m’irrite, tout en sachant que ma présence l’irrite également.
L’homme de famille, ayant failli à protéger ses deux femmes. C’était ça, que je m’imaginais qu’elle pensait. Et même si jamais elle ne me l’a dit ouvertement, son regard, lui, ne pouvait mentir…
Alors, je m’enferme dans l’alcool.
Un verre de vin par jour, au début. Qui se transforme en une bouteille de cinquante centilitres. Qui devient une bouteille d’un litre.
Qui devient, dans mes moments les plus bas, une bouteille de whisky… ou deux…
Cette dépendance en entraîne une autre.
Mon appétit sexuel, d’homme non comblé dans son foyer, se transforme en obsession pour les films pornographiques, suivi bientôt de rencontres nocturnes avec des escortes tout plus dépravées les unes que les autres.
Aujourd’hui, ces escortes me répugnent autant que je me répugne moi-même, après une énième jouissance mécanique, dans une énième escorte, dont le nom et le visage m’échappent encore.
Mais… est-ce bien important ?
Maintenant que ma femme me demande le divorce.
À moi, celui qui fut son heureux mari. Celui qui fut sa source de bonheur.
Ce matin, arrivé en retard à mon lieu de travail pour la énième fois, je croise mon manager dans les couloirs, un homme juste, mais intransigeant. Il avait toujours su me couvrir, conscient de ma situation, de mes travers, et des raisons pour lesquelles je ne suis plus que l’ombre de l’homme que j’étais avant que le drame ne s’abatte sur ma famille.
Autrefois l’un des meilleurs vendeurs, à présent je ne suis plus, au mieux, qu’à la hauteur des meilleures nouvelles recrues. Autrement dit, à peine rentable aux yeux de mes patrons, qui n’attendent qu’un faux pas de plus pour me remercier et me mettre à la porte.
Dans un sermon qui sonnait plus comme un dernier avertissement, mon manager me dit alors que, même dans les pires moments de la vie, l’essentiel est d’éviter de s’ajouter un problème de plus.
À ce stade, mon travail est la seule chose que je puisse encore sauver, ou du moins celle dont je détiens encore les clés pour ne pas sombrer davantage.
Ses paroles, me frappent comme un électrochoc.
Je prends conscience que je suis devenu un paria au sein même de mon équipe. Rétrogradé, je finis ma journée en atteignant à peine la moitié de mon objectif journalier. Une réussite pour moi, ayant encore des relents de whisky dans l’haleine, les yeux boursouflés de ma nuit blanche.
À la sortie du bureau, je vois une petite brocante nocturne et décide, sous les conseils d’un collègue, de prendre l’air, de me remettre à vivre. En réalité, ce que je redoute le plus, c’est de rentrer à la maison.
Une maison, sans joie. Sans chaleur. Sans âme...
Cette ambiance pesante m’avait d’ailleurs provoqué plusieurs ulcères à l’estomac, diminuant, par la même occasion, encore plus mon espérance de vie, déjà bien rognée par ces nouvelles habitudes.
Dans cette brocante, je me promène, déambule entre les étalages...
J’observe les gens. Juge les gens. Envie les gens.Me remémorant que ma vie, il y a encore deux ans, était parfaite.
La brocante était l’une des plus connues du Marais, et avait lieu chaque premier vendredi du mois, en soirée.
Plusieurs stands de vendeurs de hot-dogs, de pain saucisse et de friterie me font de l’œil. La fumée de viande grillée me rappelle que, malgré tout, je suis humain, et que ces choses, vitales, restent aussi délicieuses et appétissantes, même lorsqu’on est devenu, comme moi, un déchet.
Je m’approche de la baraque à frites, prêt à sortir mon portefeuille.
— Des frites, ketchup, et deux grosses boulettes dégoulinantes de sauce, pensai-je, avant de passer devant un stand qui vend des bijoux ésotériques artisanaux.
Je m’approche alors du stand.
Une table en bois sommaire, quelques bâtons d'encens brûlant posés sur l'étal recouvert d'une nappe en nylon rouge, et des présentoirs où sont exposés des bougies et des bijoux sertis de quartz, d'améthyste, de rose des sables et d'autres minéraux.
L’un des deux vendeurs, un nègre à la barbe grisonnante poivre et sel d’une cinquantaine d’années, me remarque. Sans attendre, il s’approche et entame son discours commercial.
Son français est approximatif, mais compréhensible.
Il me montre alors un bracelet et m’assure qu’il me portera chance si je le porte.
— Vingt-cinq euros ! dit-il en me souriant.
Je lui rends son sourire et lui réponds que je n’ai que quinze euros sur moi. Au même instant, je feins de m’intéresser à d’autres bijoux, bien moins coûteux, sur son étalage, espérant une réaction rapide de sa part.
Finalement, il me le laisse à vingt euros. Il m’offre en prime un cadeau pour ma femme : une bague porte-bonheur, dont il tente de me faire croire qu’elle fut forgée par les elfes au pays d’Òdon, puis amenée en Afrique par ses arrières-grands-parents au terme de multiples péripéties, pour finalement atterrir sur ce stand. En plein Marais.
— Un bijou de famille… Si tel avait réellement été le cas, jamais, il ne me l’aurait offerte pour si peu, me dis-je.
Je souris à mon tour, le félicitant pour sa technique commerciale, puis je prends mon paquet de frites et mes deux boulettes du stand voisin avant de rentrer chez moi, la boule au ventre.
Le traumatisme de mon agression ne s’est toujours pas estompé avec le temps. Chaque soir, avant de pousser la porte du hall d'entrée de ma maison, par réflexe, je jette un regard par-dessus mon épaule, vérifiant que personne ne me suit.
Et quand bien même ce serait le cas... si l’homme était armé, je ne chercherais plus à me débattre pour survivre. Je lui demanderai simplement d’en finir au plus vite. Et de tirer sur la détente en plein cœur.
Finalement, j’ouvre la porte de la maison et traverse le salon. En silence. Ma femme est affalée sur le divan, le regard vide tourné vers la télé, qui beugle des informations aussi moroses que le temps au Marais.
Une odeur de renfermé, mêlée à la transpiration et à la cigarette, flotte dans la pièce mal aérée.
Sans un mot, ni un regard porté à ma femme, je me dirige vers la cuisine, au fond de la pièce, et m’assois sur un tabouret.
Devant moi, mes deux nouvelles acquisitions.
— De la chance… murmurai-je en observant le collier.
Un simple cordon duquel pend un quartz rose poli. Je desserre ma cravate, ouvre les premiers boutons de ma chemise et passe le bijou autour de mon cou, sans trop savoir combien de temps je le garderai avant de m’en lasser.
Puis, je sors la bague du petit sachet en papier brun dans lequel le vendeur l’avait emballée.
— Étrange… me dis-je en l'observant à la lumière.
L’anneau est fait d’une sorte de liquide solidifié en perpétuel mouvement. Sans jamais changer de forme.
Au sommet de la bague se trouve un orbe de verre rempli d’un gaz bleu irisé, serti avec une précision envoûtante. L’intérieur de l’orbe paraît aussi infini qu’une galaxie, traversé par des myriades de points gazeux lumineux. Mes yeux s’attardent alors sur ce qui maintient cet orbe.
Lorsque j’agite la bague, la penche, de gauche à droite, les éléments se mélangent. Et l’anneau, lui-même, paraît se mouvoir comme les eaux d’une rivière en mouvement. Comme un liquide solide.
— Peut-être finalement que ce nègre me disait la vérité… Me dis-je en enfilant la bague à mon petit doigt.
Après quoi, je finis par me cloîtrer dans mon bureau.
La porte fermée, je m’adonne alors à mes deux passions préférées. La boisson, en vidant une énième bouteille de vin, et le porno, m’abandonnant à un plaisir solitaire.
Le lendemain matin, en me réveillant dans la chambre d’amis, je réalise que j’avais encore dormi tout habillé. Chaussures et cravate encore sur moi. Le cendrier qui déborde de mégots, et mon verre de whisky, à moitié vidé, traîne sur la table de chevet.
Mon premier réflexe est de l’achever d’une traite.
La gueule de bois me vrille encore le crâne. Je me traîne avec rigidité et lourdeur jusqu’à la salle de bain. D’un geste négligent, j’arrache mes vêtements et les laisse tomber à même le sol.
Je retire ensuite le collier de cristal de mon cou, déjà honteux d’avoir cru, ne serait-ce qu’une seconde, qu’un simple caillou puisse me porter bonheur. Puis, je tente d’ôter ma bague.
Elle résiste.
Impossible de la faire glisser hors de mon auriculaire.
Je passe ma main sous l’eau chaude, la couvre de savon et tire de toutes mes forces.
Rien à faire. La bague reste obstinément vissée à mon doigt.
Nu, face au miroir, je contemple le reflet de mes échecs, avec l’impression que, en l’espace d’une nuit, plusieurs années se sont gravées sur mon visage.
Puis, mon regard glisse vers ma montre. Je suis déjà en retard.
— Je réglerai ça plus tard, soufflai-je.
Je prends une douche rapide, m’habille et quitte la maison sans un mot pour ma femme, qui n’a pas bougé du canapé depuis la veille.
Une fois arrivé au bureau, je me retrouve face à des portes closes.
Samedi.
Putain.
Pestant contre le monde entier, je me dis que, finalement, la journée aurait pu être pire. Alors, autant la précipiter dans le néant.
À neuf heures du matin, je me retrouve en costume, rasé de près, mais les traits tirés, attablé à la terrasse d’un café, une bière pour seul déjeuner.
Une jeune femme d’une vingtaine d’années s’installe à la table voisine. Plongé dans mes pensées, je ne remarque même pas qu’elle a fait une remarque sur la bague à mon doigt.
Je lève les yeux vers elle.
Elle est parfaitement mon genre. Traits fins, cheveux noirs et lisses, regard sombre et aguicheur. Malgré son âge, son charme ne me laisse pas indifférent.
N’ayant rien de mieux à faire, je décide d’entrer dans la danse et l’invite sans détour à prendre place à ma table, dégageant mon porte-document pour lui faire de la place sur la chaise à ma droite.
À ma grande surprise, lorsqu’elle passe commande, elle prend une bière. Me laissant sous-entendre qu’elle a quelque chose à fêter par sa manière d’être.
On passe ainsi toute la matinée à discuter, sans voir le temps filer.
J’apprends, non sans tristesse, qu’elle venait de perdre sa mère, emportée par la maladie. Comme un malheur n’arrive jamais seul, elle avait également découvert que son copain, avec qui elle partageait sa vie depuis près de deux ans, menait un double jeu.
Je l’écoute, captivé malgré moi. J’observe ses lèvres bouger, ses fossettes se creuser à chaque mouvement de mâchoire. Et une seule pensée m’obsède à cet instant. La coucher dans mon lit.
— Qu’attend-elle d’autre de moi ? me dis-je.
Moi qui pourrais aisément passer pour son père.
Midi sonne.
Le ventre repu de mes quatre bières et du hamburger partagé avec Jessy, je savoure encore cet instant, convaincu qu’il ne se répétera pas. Une simple parenthèse éphémère dans ma vie, destinée à se refermer aussi vite qu’elle s’est ouverte.
Mais il fut ce qu’il devait être, après l’avoir pensé.
Chaque jour, durant les deux mois qui suivirent notre rencontre, je me retrouve à cette même terrasse, terminant mes soirées en compagnie de Jessy.
Elle, si jeune, si sauvage.
Dans sa manière d’être, il n’y avait aucune dissonance. Aucun jugement.
— Je suis une vieille âme, dans un corps jeune, répétait-elle souvent.
Elle en vint à m'expliquer que la bague que je porte est un talisman elfique. Selon elle, la force qu’elle peut m’accorder dépend entièrement de l’importance et de l’attention que je lui accorde.
Je ris.
Je lui raconte comment, plusieurs fois déjà, j’avais tenté de l’enlever, en vain.
Comment j’avais tenté à plusieurs reprises de retrouver ce nègre qui me l’avait vendue, mais sans succès.
Comment j’avais même essayé de la couper avec une pince en fonte, qui s’était brisée net.
— Je n’ai plus mis les pieds dans une église depuis mes dix-huit ans. Mais, je sais reconnaître un signe divin lorsqu ‘il se manifeste, lui soufflai-je en la prenant par la taille, avant de poser mes lèvres sur les siennes.
Douces, sucrées...
Elle ferme les yeux, prend mon visage entre ses mains et s'abandonne à moi. Autour de nous, sur la terrasse, je sens les regards, chargés de jugements. Mais qu’importe.
À cet instant, je me sens revivre. Jessy vient de rallumer en moi une flamme que je croyais éteinte depuis longtemps.
Alors, je l'invite à finir la nuit chez moi. Elle hésite. Consciente que je vis toujours avec ma femme. Mais il ne me faut guère insister plus longtemps. Jessy est de celles qui aiment les interdits.
Elle pince ses lèvres. Me lance un regard indéchiffrable, sulfureux et sombre, tout en caressant ma masculinité à travers le tissu fin de mon pantalon. Ce simple geste fait naître en moi un désir encore plus intense. Elle accepte.
Et ce soir-là, Jessy pénètre pour la première fois dans ma maison. Comme à son habitude, ma femme ne relève même pas la tête en m’entendant rentrer. Les bruits des talons de Jessy résonnant sur le carrelage du corridor ne semblent pas non plus l’émouvoir.
Puis, dans un élan d’audace qui me prend de court, Jessy ose la saluer en passant devant ma femme, avant de déposer son manteau sur le fauteuil à bascule en angle de la pièce.
Ce geste provocant, insolent… m’excite encore plus.
Je poursuis l'outrance, et offre à Jessy un verre de gin dans la cuisine qu'elle termine d'une coudée. Puis, je l’embrasse langoureusement, et l'invite finalement à monter dans la chambre d’amis.
Tandis qu’elle gravit les marches, je ne peux m’empêcher d’observer les ondulations de son corps, la cambrure de ses reins qui se dessinent sous sa robe. Mais, pris d’un bref remords, je jette un regard furtif vers ma femme.
Elle est redressée dans son fauteuil.
Elle pleure.
En silence.
À peine la porte refermée, Jessy, dans toute la fougue de sa jeunesse, se jette à mon cou, arrache ma chemise dans un éclat de boutons projetés aux quatre coins de la pièce.
D’un geste aussi vif, elle fait glisser son chemisier, le jetant sur la commode. Dévoilant sa nudité. Sa poitrine exquise et ferme, dont je vais me délecter.
Je suis prêt. Dur.
Je prends mon temps. Savoure chaque instant. Chaque parcelle de son corps.
Le goût de sa peau, si pâle, si chaude, si douce, son odeur boisée…
Je sens son pouls s’accélérer, le mien suivre le même rythme, tandis que sa respiration se fait plus fiévreuse.
Puis, dans un élan bestial, je la retourne contre le mur.
La lampe de chevet bascule, s’écrase au sol dans un bruit sourd, plongeant la pièce dans l’ombre. Seule la lumière tamisée de la lune, filtrant à travers la fenêtre ouverte, éclairait mon acte.
Alors, je la prends.
Encore. Encore. Et encore…
Jusqu’à l’épuisement.
Jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien.
Ni en moi.
Ni en elle.
Le lendemain matin, c’est seul que je me réveille dans ce grand lit, à présent si froid, sans la chaleur de Jessy.
Mais son odeur, son parfum, embaument encore les draps.
Ma femme, quant à elle, a disparu. Mais sa voiture est toujours garée dans l’allée.
— Probablement cloîtrée dans sa chambre à contacter son avocat pour accélérer le processus de divorce… me dis-je, en songeant que j’ai peut-être été trop loin cette nuit.
Ni une ni deux, je me prépare un petit-déjeuner copieux : des œufs, des tartines au fromage et un café bien serré pour me réveiller. Assis à la table, portable en main, je passe en revue distraitement les actualités. Puis, plusieurs notifications attirent mon attention.
Des dizaines de messages. Des amis, de la famille, même des inconnus m’identifient sur plusieurs articles de la presse locale, relayés par différents médias.
Intrigué, je clique.
Et mes doigts lâchent ma tasse de café brûlant, qui s’écrase au sol dans un bruit sourd.
La justice venait de relâcher les hommes qui, deux ans plus tôt, avaient détruit ma famille.
Un coup de poignard.
Mon premier réflexe fut de penser à ma fille. Mon ange parti trop tôt. Privée d’avenir par ces monstres.
Des larmes de rage coulent sur mon visage, crispé par la haine et un profond mépris pour la justice de ce pays.
Les noms et visages des bourreaux ont été dévoilés. Les commentaires défilent, réclamant vengeance en son nom, au nom de ma femme, en mon nom.
Je serre le poing. Rumine ma colère.
Puis, incapable d’apaiser le feu qui me consume, je me sers un verre de whisky.
Un deuxième.
Un troisième...
Jusqu’à ce que la haine s’étouffe dans l’ivresse. Jusqu’à ce que je prenne le volant, titubant de colère et d’alcool, en direction du travail.
Mon manager, ayant lui aussi appris la nouvelle, m’offre ma journée.
Un cadeau empoisonné, avant que mon patron ne me voie dans cet état lamentable et ne décide de me virer définitivement.
Alors, à neuf heures vingt, je me retrouve une fois de plus sur cette putain de terrasse.
Débraillé. Le regard hagard, posé sur ma première bière, noyant ma tristesse.
Et puis, Jessy apparaît. Aussi belle et sauvage que la veille.
Aussi précieuse que fugace, tel un chaperon sur la tignasse d’un bambin.
Elle s’installe en face de moi, croise ses jambes, laissant apparaître plus qu’il n’en faut de ses cuisses découvertes.
D’une voix douce, mais tranchante, elle susurre à mon oreille qu’elle sait pourquoi je suis dans cet état… et qu’une seule chose doit être faite.
Ses mots me font lever la tête.
— Un homme, un vrai, protège l'honneur de sa famille, poursuit-elle en plantant son regard dans le mien.
Le silence pèse, se prolonge, s’éternise.
Puis elle ajoute, plus impérieuse encore :
— Laisse gronder ce que tu as dans le ventre... N’aie pas peur de tes pulsions, mon homme.
Un frisson me parcourt l’échine.
Ses paroles sont plus brutales que d’ordinaire. Plus dérangeantes.
Mes pulsions...
Son regard me permet de deviner ses pensées. Elle me dit alors que si moi, un homme, je ne suis même pas capable d’honorer la mémoire de ma fille, mon sang, ma chair…
Alors, je ne mérite plus son temps, et qu’elle regrette d’avoir passé la nuit avec un être tel que moi.
— Es-tu de ces hommes ? me dit-elle, tout en me laissant lui embrasser le cou. Es-tu l’un de ceux qui rechignent à faire ce qu’ils désirent vraiment faire ?
Son parfum charnel, sa voix… Tout en elle me transcende.
Et, à cet instant, Jessy devient mon obsession.
Elle m’embrasse à son tour, avant de disparaître, mais… je ne ressens de sa part aucune tendresse.
Et ce fut un spectre que j’embrassai.
Huit jours plus tard, j’y suis.
Dans ce parc mal éclairé de l’esplanade du Marais. Caché dans le creux d’un érable. Un maillet en fonte serré dans ma main.
Ivre de rage.
Je suis un pitbull en chasse. Mon cœur cogne contre ma cage thoracique, battant au rythme de ma haine. Le visage de ma fille hante mon esprit. Ses rires. Ses pleurs. Ses derniers mots.
Oh, ma fille... qui suis-je sur le point de faire en ton nom...
Les paroles de Jessy tournent et résonnent en boucle dans ma tête. Laisser gronder ce que j’ai dans le ventre…
Puis, je le vois. Seul.
Sortant de la cage d’escalier de la sortie de la station de métro, et passe à ma hauteur. Sans même se douter un seul instant qu’il venait de croiser son bourreau.
L’homme rit au téléphone, insouciant. Libre. Comme si de rien n’était.
Mais aujourd’hui, c’est moi qui lui arracherai la vie.
Je serai son juge vendu… Et son bourreau par choix.
Sans même prendre le temps de réfléchir plus qu’il ne faut, je lui bondis dessus.
Ma fureur s’abat sur lui comme un jugement divin. Le maillet fend l’air et s’écrase sur sa boîte crânienne, qui éclate instantanément sous l’impact.
Son corps s’effondre sur le trottoir, comme une vulgaire marionnette désarticulée.
Mais, enragé, je continue de le cogner…
Encore. Encore. Et encore…
Mais je prie pour que l’homme survive à chacun de mes coups, afin de pouvoir lui en infliger un autre, encore plus douloureux.
— Je t’interdis de crever si vite, sac à merde !
Le sang gicle. De la matière cérébrale éclabousse le sol, mes chaussures, mon visage et mes vêtements.
Les coups pleuvent, violents et brutales.
Jusqu’à ce que son visage ne soit plus qu’une masse informe, méconnaissable, déformée, édentée.
Je cours ensuite, haletant, vers ma voiture. Je saute à l’intérieur, les mains crispées sur le volant en cuir.
Mais une douleur fulgurante me fait grimacer.
Ma bague. Cette putain de bague !
Elle se resserre. Me brûle la peau. Me ronge la chair !
Des veines pourpres et mauves, saillantes sous ma peau, remontent lentement, sinueuses, traçant un réseau malade jusqu’à mon avant-bras. Jusqu’à mon cou.
La douleur pulse, lancinante, et s’enracine plus profondément en moi. Comme si quelque chose prenait possession de mon corps. Je hurle de douleur dans ma voiture, tout en démarrant en trombe vers chez moi.
Sous la douche, je tremble encore...
L’eau ruisselle sur moi, brûlante, mais elle ne lave en rien les images imprimées de mon esprit.
Je peine à comprendre ce que je viens de faire.
Alors, pour fuir, pour m’ancrer dans quelque chose de tangible, je m’enferme dans mon bureau...
L’écran s’illumine, et je fais défiler un flot d’images pornographiques. Plus extrêmes. Plus violentes encore qu’avant.
Une main sur ma masculinité en exaltation, l’autre naviguant sur l’écran. Un filet de bave coule hors de ma bouche.
Mais soudain, tout se brouille dans mon esprit, et les yeux et le rire sournois de Jessy m’apparaissent du néant.
Le dégoût acide de ma propre personne m’envahit.
Je fonds en larmes, puis l’effroi me submerge…
Je réalise enfin ce que je suis devenu.
— Dieu… Je viens de tuer un homme. Voudras-tu encore de moi ?




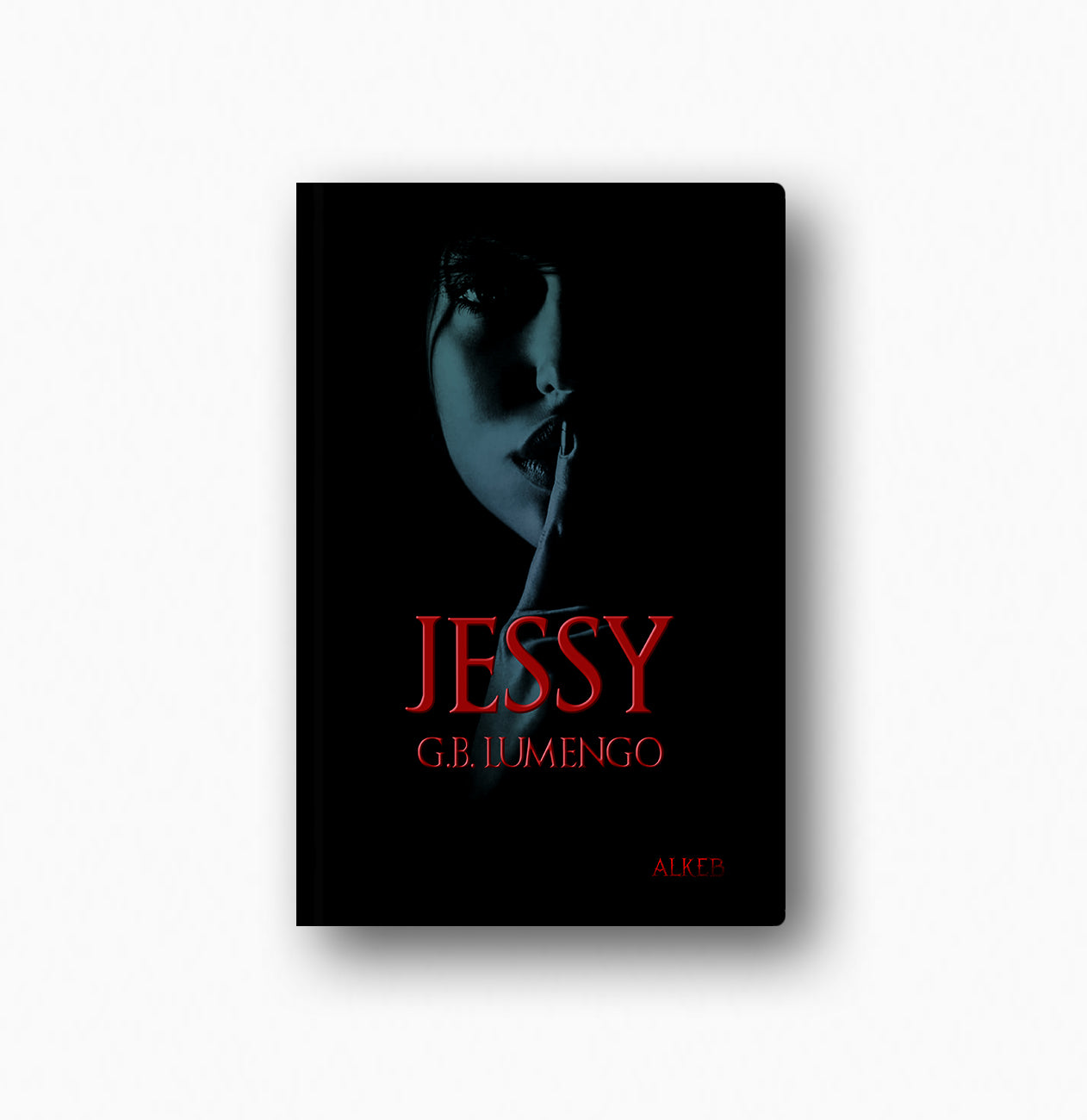
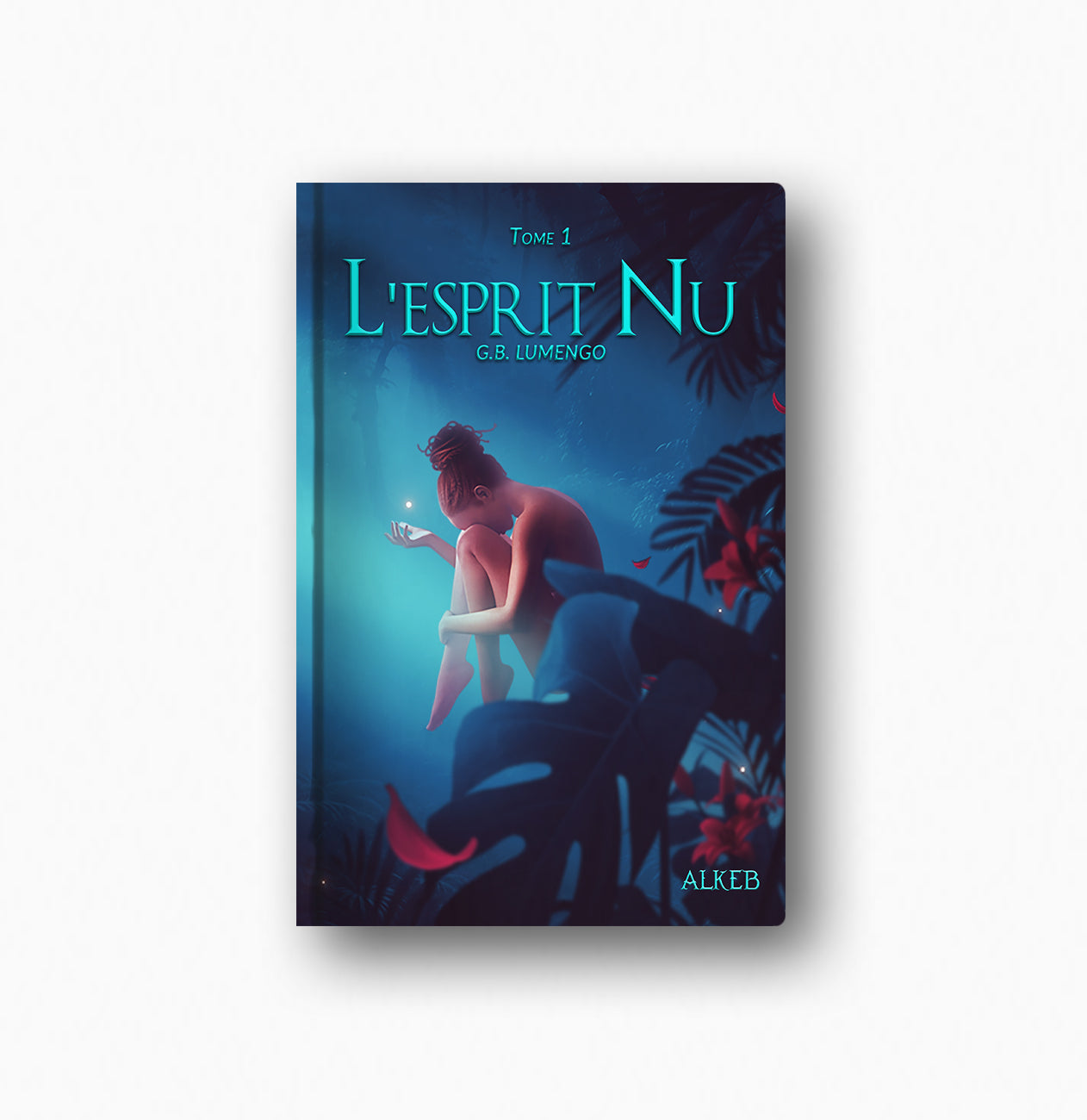
Partager l'article:
La forêt de Jade